Tribune / « Ecole : nous avons besoin d’un nouveau récit mobilisateur »
Publié le lundi 22 septembre 2025
En novembre 2017, le président nouvellement élu, Emmanuel Macron, se rendait à Clichy-sous-Bois, Roubaix et Tourcoing pour promettre aux quartiers populaires une politique d’« émancipation » et de lutte contre l’ « assignation à résidence ». Une politique qui passait « d’abord et avant tout par l’école », affirmait-il.
Un quinquennat et demi plus tard, qu’en est-il de cette promesse ? Où en est l’école ? Depuis 2022, c’est la valse des ministres de l’Éducation nationale : nous attendons aujourd’hui un énième locataire de la rue de Grenelle, le huitième en trois ans. Depuis plusieurs années, chaque rentrée scolaire donne lieu à une opération de communication, reposant sur des demi-mesures – comme l’interdiction des téléphones portables, déjà prévue dans la plupart des règlements intérieurs des collèges – ou sur l’instrumentalisation politicienne de sujets comme l’abaya.
Pendant ce temps, la crise du recrutement des enseignants s’enkyste. Pendant ce temps, l’école de la République devient une regrettable machine à reproduire les inégalités sociales. L’étude PISA renouvelle désormais chaque année ce triste constat : la France est le pays de l’OCDE dans lequel le statut social des parents détermine le plus fortement les performances des élèves.
Voici la réalité : l’Éducation nationale n’a plus de cap. Plus de vision à long terme, plus de projet mobilisateur. Nous naviguons à vue, au gré des polémiques du moment, ballotés entre coups de com’ et petites phrases, freinés par des considérations budgétaires court-termistes. Prédomine ainsi une conception étriquée de l’éducation, recroquevillée sur des slogans – « rétablir les savoirs fondamentaux » – sans jamais interroger leur contenu et leur pertinence à l’aune des grands défis qui se posent aujourd’hui et pour l’avenir.
Comment renforcer l’attractivité des métiers ? Comment redonner à l’éducation nationale les moyens à la hauteur de besoins dûment constatés ? Comment répondre aux enjeux nouveaux et absolument déterminants comme celui de l’irruption fulgurante de l’intelligence artificielle ? Comment lutter contre le « séparatisme scolaire » des privilégiés ? Autant de questions auxquelles aucun récit d’ensemble ne vient donner une réponse. Et dans un pays comme la France, où l’école est la pierre angulaire de la promesse républicaine, parce qu’elle est son principal instrument d’émancipation et d’unification des citoyens, cette absence de projection est un vide grave.
Pire, ce vide permet aux réactionnaires et populistes de dérouler leur projet éducatif qui n’a besoin ni d’enseignants ni d’élèves à l’esprit critique aiguisé.
Or, dans l’histoire de notre pays, l’école est venue répondre à des grands objectifs partagés, comme sous la IIIème République où il s’agissait pour l’école publique d’enraciner le nouveau régime dans la société française, en façonnant des républicains convaincus, sous la direction des fameux hussards noirs, ou à l’image des années 80 où l’horizon fixé à l’école était celui de la démocratisation : amener toute une classe d’âge vers le baccalauréat.
Mais aujourd’hui, quel grand récit, quel projet mobilisateur adapté aux enjeux de notre époque, souhaitons-nous voir l’école endosser pour embarquer la société ? L’école a besoin d’un idéal à poursuivre. Sans ce carburant, elle tournera à vide, incapable de fédérer et donc d’être forte.
Voici à quoi, de manière urgente, nous devons nous atteler collectivement : construire un nouveau récit mobilisateur. Il doit répondre à plusieurs enjeux si nous voulons qu’il façonne la société de demain. J’en pose 2 principaux qui me semblent transversaux.
Le premier c’est de pouvoir opposer un modèle robuste au mouvement de fond qui imprime le plus profondément sa marque qui est la progression de l’individualisme – le repli sur soi et sur sa sphère privée – et son corollaire, une société de plus en plus fragmentée. L’une des origines de cette transformation est indubitablement le bouleversement presque anthropologique induit par la révolution numérique : puissance d’attraction des écrans et maintenant explosion de l’utilisation de l’intelligence artificielle. La transmission du savoir en est frappée de plein fouet. Il s’agit de trouver un chemin de crête entre les deux pièges que constituent une « technophobie » réflexe ou une « technolâtrie » aveugle. Nous devons anticiper lucidement tous les effets à long terme qu’entraîne cette nouvelle force numérique sur le développement humain pour tenter d’en tirer le meilleur. Il est d’ailleurs étonnant qu’un pays présidé par le héraut de la « start-up nation » ne soit pas davantage à la pointe dans les réflexions à ce sujet.
Alors que l’accès à la connaissance s’établit de plus en plus selon un rapport de consommation immédiate de données qui semblent se valoir toutes, sans l’intermédiation de l’enseignant, il faudra que l’école repense le cœur de sa mission. Elle peut ainsi être le refuge de l’irremplaçable sensibilité et du discernement humain. Elle peut être aussi le lieu où l’on apprend, non pas seulement à utiliser ces outils numériques mais aussi et surtout comment les fabriquer et donc les maîtriser, avec par exemple la mise en place de la programmation et du code au niveau d’une langue vivante.
Mais, le morcellement de nos sociétés est aussi le résultat d’un terrible creusement des inégalités ces dernières décennies, lui-même conséquence des politiques néolibérales. C’est le 2ème enjeu majeur auquel l’École doit faire face car elle n’est évidemment pas épargnée, avec un niveau effarant de ségrégation sociale qui s’installe dans les établissements scolaires. L’école devient de plus en plus un univers d’ « entre-soi », voulu ou subi. C’est tout l’inverse de sa vocation et c’est un péril mortel pour LA cohésion de notre société qui a besoin que les enfants de la République apprennent et grandissent ensemble. Il y a urgence à ce que l’école retrouve sa capacité à fabriquer du commun.
Il est grand temps de faire de l’école la grande épopée du XXIe siècle : non pas une institution qui entretient les fractures, mais un lieu qui émancipe, qui rassemble et qui prépare un avenir du progrès partagé.
À lire également
-

31 octobre 2025
Discours prononcé en hommage à Zaïnaba Saïd-Anzum
-

30 octobre 2025
Décès de Zaïnaba Saïd-Anzum, conseillère départementale déléguée
-

24 octobre 2025
Tribune / Faire du Grand Paris Express un objet politique qui change la vie des Franciliens
-
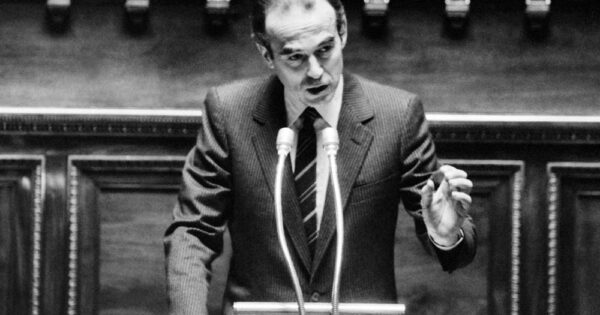
9 octobre 2025
Badinter au Panthéon : la politique au service de la dignité humaine




